Jean-Michel Jacquemin-Raffestin
« On peut tromper tout le monde pendant un certain temps et certains pour toujours, mais on ne peut pas tromper tout le monde éternellement. » Abraham Lincoln
Ces fameux mensonges d'Etat : Tchernobyl - Чорнобиль – Chornobyl – Czarnobyla -Tschernobyl – Ciernobil – Чернобыль – Chernobyl - Fukushima - 福島 - Фукусима -
La Covid-19, le graphène, la protéine Spike et les effets secondaires
La guerre des Etats-Unis à la Russie sur le dos des Ukrainiens et des Européens
« Une erreur n’est pas une vérité parce qu’elle est partagée par beaucoup de gens. Tout comme une vérité n’est pas fausse parce qu’elle est émise par un seul individu. » Gandhi
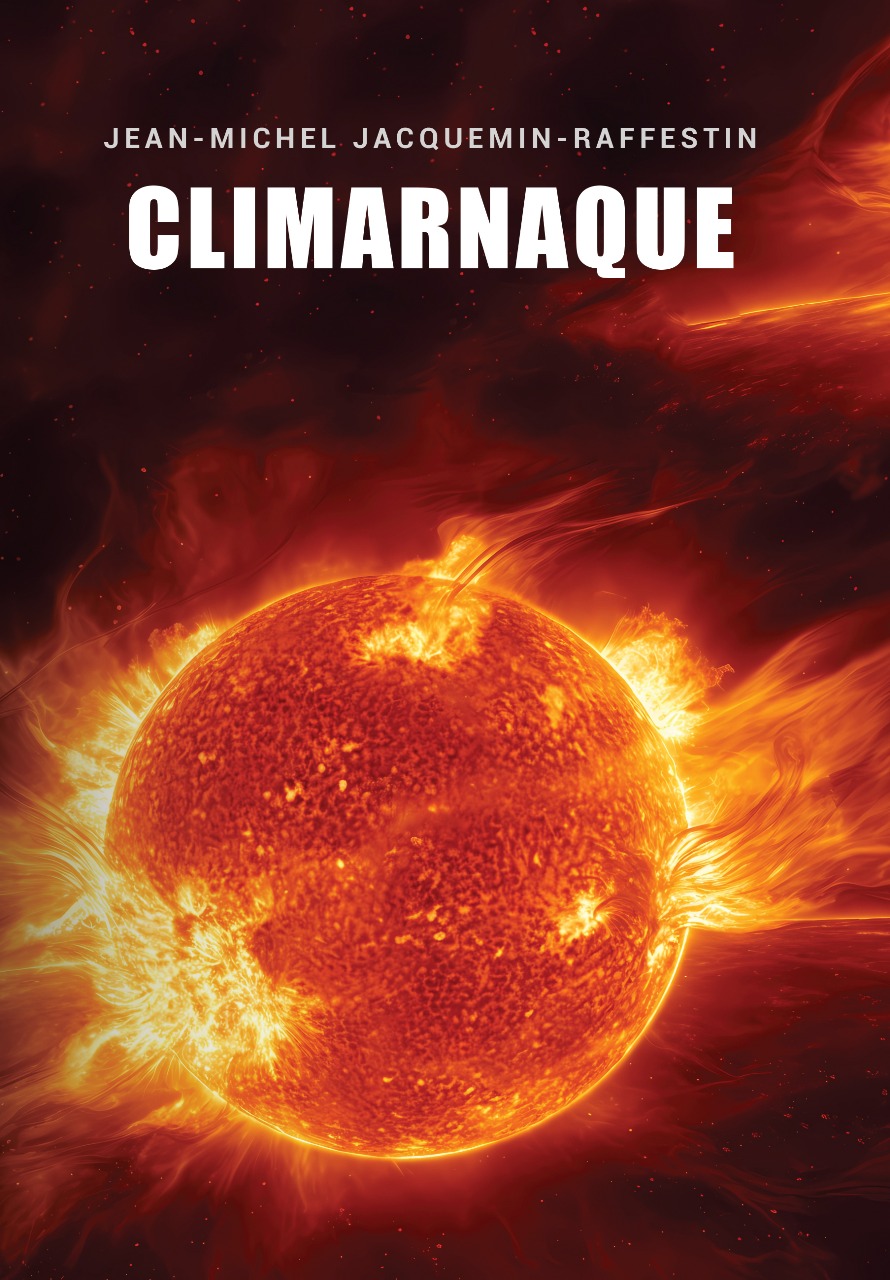
Le changement climatique et la protection de notre planète Terre sont des slogans de propagande qui s'infiltrent journellement dans presque toutes les conversations, les médias, les débats publics, les conversations familiales. Il doit être omniprésent pour effrayer les populations peu instruites sur le sujet et leur imposer des restrictions de liberté.
C’est l’homme le coupable, le réchauffement de la planète est forcément anthropique, il est tellement facile de faire payer à la population des taxes, de lui restreindre ses déplacements, (pour ce faire, la voiture électrique est un bon moyen). Ils veulent empêcher les citoyens de se déplacer librement dans les villes au nom de la synchro sainte écologie. En un mot, de la surveiller davantage.
Aujourd’hui où l’éducation dans les écoles, collèges, universités n’a plus aucune valeur, où l’on préfère enseigner des actes sexuels à des enfants en bas âge, plutôt que les bases de la vie, on fabrique des crétins qui acceptent ce qu’on leur impose sans même se poser de question.
Ce livre remet en place le passé, car avant de nous prédire le futur, peut-être pourrions-nous expliquer le passé ? Que s’est-il passé sur notre planète depuis 4, 5 milliards d’années ?
Comment, quand l’homme n’était pas présent, le CO2 a-t-il parfois, été 20 fois supérieur ? Comment des continents, des civilisations ont disparus ? Comment, d’autres sont apparus ? Comment en 9000 ans, l’Europe a-t-elle connu une dizaine de fois des forêts de chênes, puis la Toundra ?
Ce livre permet de connaitre le passé de notre Terre que l’on n’enseigne plus, d’où la facilité de faire croire ce que l’on veut aux « gueux ». Les explications et les études sur le CO2 depuis des centaines de millénaires existent : les différents changements climatiques à une époque où l’homme n’était pas présent sur Terre, l’activité solaire, très importante, dans le changement et le réchauffement de la planète que les médias oublient.
Ce fameux CO2 qui ne représente que 0,04 % de notre atmosphère, savez-vous qu’à 0,02 % la végétation meurt, l’homme meurt, la vie s’arrête. De nombreuses études montrent que le CO2 suit l’augmentation de chaleur avec 800 ans de retard. Ils ne veulent pas sauver la planète, au contraire, ils font tout l’inverse, la déforestation massive, les voitures électriques et leur pollution plus important que celle des voitures thermiques qui ne doivent plus exister en 2035 selon le désir d’Ursula. Vous parle-t-on de ces enfants de 8 ans qui descendent dans les mines en Afrique pour extraire les matières qui servent à votre batterie de voiture ? En d’autres temps, cela s’appelait de l’esclavage, est-ce sauver la planète ? Le mouvement environnemental avec son « Net Zéro » voulu est une idéologie anti-humaine, une étude explique qu’il va provoquer la mort de 4 milliards de personnes. Avez-vous compris ce qu’ils veulent ? La dépopulation de la planète dont ils parlent depuis un demi-siècle.
L'objectif de ce livre, premier tome d’une trilogie, est un appel à se réveiller, à sauter dans le train de l'illumination et à grandir dans l'unité jusqu'à une masse critique pour résister à cette tyrannie imposée.
Il est temps de découvrir la Vérité sur ce thriller climatique dystopique que l’on nous impose.
POUR LE COMMANDER :
https://librairie.bod.fr/climarnaque-jean-michel-jacquemin-raffestin-9782322623747
