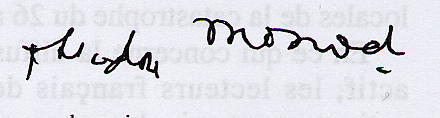Préface Corinne Lepage
Expiré L’ouvrage de Jean-Michel Jacquemin-Raffestin arrive à point nommé. En effet, le lourd silence est retombé sur Fukushima peut-être plus encore qu’il n’enveloppe Tchernobyl. Peut-être parce que les retombées radioactives ont paru moindres dans le cas de Fukushima que dans celui de Tchernobyl, que la pollution des océans ne se voit pas et que le nuage à l’évidence été plus modeste que celui de son prédécesseur.
L’ouvrage de Jean-Michel Jacquemin-Raffestin arrive à point nommé. En effet, le lourd silence est retombé sur Fukushima peut-être plus encore qu’il n’enveloppe Tchernobyl. Peut-être parce que les retombées radioactives ont paru moindres dans le cas de Fukushima que dans celui de Tchernobyl, que la pollution des océans ne se voit pas et que le nuage à l’évidence été plus modeste que celui de son prédécesseur.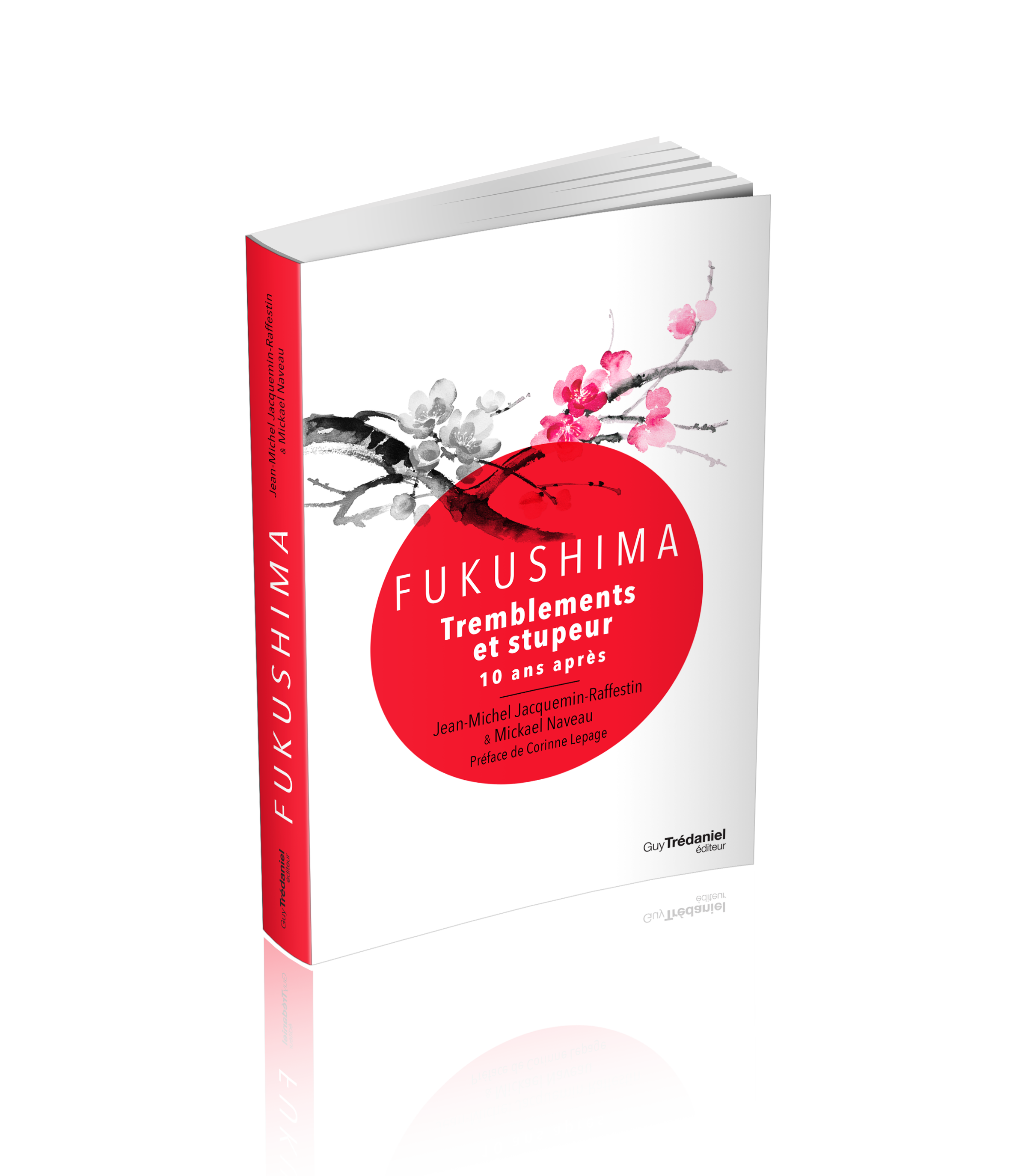
Il n’en demeure pas moins que les mêmes causes produisent les mêmes effets et que le lobby nucléaire à œuvrer pour Fukushima comme il l’avait fait pour Tchernobyl en organisant le silence et surtout l’absence d’études sérieuses et contradictoires sur l’impact réel en terme sanitaire et environnemental de la catastrophe. Alors que 30 ans nous séparent de l’explosion de Tchernobyl, il n’y a toujours aucun consensus sur l’étendue de la catastrophe sanitaire, entre les 20 morts reconnus par certains dont le professeur Tubiana et les centaines de milliers de morts évoqués par des études sur les liquidateurs. Au-delà des morts, les victimes physiques et psychiques se comptent, elles, en millions comme l’a reconnu l’ancien secrétaire général des Nations unies. En fait, tout a été organisé pour permettre « la méconnaissance scientifique », ce qui permet aux défenseurs du nucléaire de continuer à soutenir qu’il s’agit d’une énergie sans danger.
Pourtant, dans le même temps, la première cartographie mondiale du taux de radioactivité naturelle et artificielle supportée par les habitants des différents pays du monde a été rendue publique. Elle met en évidence l’excès de radioactivité en France, en Russie et sur la côte est des États-Unis. Cet été, le centre international de recherche sur le cancer , dans une étude publiée le 21 juin dans la revue The Lancet Haematology, montre que l’exposition prolongée à de faibles doses de radioactivité accroît le risque de décès par leucémie chez les travailleurs du nucléaire. Malheureusement, nous ne disposons d’aucune étude correspondante et reconnue par la communauté scientifique nucléaire sur les populations vivant au voisinage de Tchernobyl et de Fukushima. Pourtant, les enfants d’aujourd’hui d’Ivankov, premier bourg situé au-delà de la zone interdite de Tchernobyl dans leur immense majorité considérés comme des victimes de Tchernobyl.
En s’attaquant sans aucun tabou à ce sujet majeur, qu’il avait déjà traité à propos de l’impact du nuage de Tchernobyl sur la France, Jean-Michel Jacquemin-Raffestin fait un travail indispensable pour que la vérité sur les conséquences des accidents nucléaires soit connue. Car les victimes le sont doublement : d’une part, dans leur chair, d’autre part dans le refus qui leur est fait de les considérer comme des victimes.
Il est essentiel que le débat puisse être enfin ouvert sur les conséquences sanitaires de Fukushima et poursuivi sur celles de Tchernobyl sans parler de Kychtym en 1957dans le complexe nucléaire Mayak A l’heure où le monde s’interroge sur ses choix énergétiques pour sortir de l’économie carbonée et où le lobby nucléaire essaye de peser pour inclure l’énergie nucléaire dans les énergies des carbonées qui seraient assimilables à des énergies renouvelables, ce qui est évidemment tout à fait faux, il est indispensable de rappeler les conséquences sanitaires liées aux accidents nucléaires et par voie de conséquence les risques insupportables auquel cette énergie expose les humains pour des générations et des générations.
Corinne LEPAGE


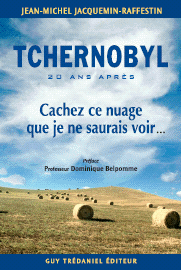
 Ces mots ont été prononcés le 29 avril par le Professeur Pierre Pellerin, Directeur du Service Central de Protection contre les Rayons Ionisants (SCPRI) Ils correspondent en tout point à l’attitude des pouvoirs publics français face à ce qui allait devenir une terrible catastrophe, un drame humain épouvantable.
Ces mots ont été prononcés le 29 avril par le Professeur Pierre Pellerin, Directeur du Service Central de Protection contre les Rayons Ionisants (SCPRI) Ils correspondent en tout point à l’attitude des pouvoirs publics français face à ce qui allait devenir une terrible catastrophe, un drame humain épouvantable.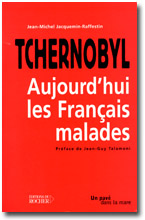
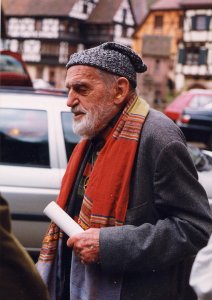 La catastrophe de Tchernobyl (26 avril 1986) n'a pas fini de terrifier l'Europe et de poser à
La catastrophe de Tchernobyl (26 avril 1986) n'a pas fini de terrifier l'Europe et de poser à un public qui refuse des informations téléguidées et partiales du lobby nucléaire, les réflexions les plus graves sur la situation la plus inquiétante créée désormais par l'impasse où la France a tenu, seule d'ailleurs parmi les nations industrielles, à se précipiter tête baissée, au risque de voir la doctrine du "tout nucléaire" conduire le pays à des dangers d'ampleur sans cesse croissants.
un public qui refuse des informations téléguidées et partiales du lobby nucléaire, les réflexions les plus graves sur la situation la plus inquiétante créée désormais par l'impasse où la France a tenu, seule d'ailleurs parmi les nations industrielles, à se précipiter tête baissée, au risque de voir la doctrine du "tout nucléaire" conduire le pays à des dangers d'ampleur sans cesse croissants. L'ouvrage de Monsieur Jean-Michel Jacquemin, nourri d'une documentation dont on appréciera la richesse et la précision, constituera un recueil des sources et des références que l'on voudrait voir largement utilisé par tous ceux qui ont la mission de dire au public la vérité et, par conséquent, en tout premier lieu, aux journalistes. On peut imaginer le volume des oppositions que la publication de cet ouvrage ne manquera pas de susciter : elles sont prévisibles mais n'enlèveront rien à la sagesse du dicton latin "amicus Plato sed magis amica véritas".
L'ouvrage de Monsieur Jean-Michel Jacquemin, nourri d'une documentation dont on appréciera la richesse et la précision, constituera un recueil des sources et des références que l'on voudrait voir largement utilisé par tous ceux qui ont la mission de dire au public la vérité et, par conséquent, en tout premier lieu, aux journalistes. On peut imaginer le volume des oppositions que la publication de cet ouvrage ne manquera pas de susciter : elles sont prévisibles mais n'enlèveront rien à la sagesse du dicton latin "amicus Plato sed magis amica véritas".